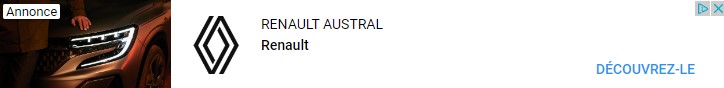Le monde du cinéma boycotte les instances israéliennes « impliquées dans le génocide »
CINÉMA – Josh O’Connor, Ayo Edebiri, mais aussi Ken Loach, Tilda Swinton et Béatrice Dalle s’unissent pour « mettre fin à la complicité ». Comme l’a relayé le Guardian, ce lundi 8 septembre, plusieurs centaines de visages du cinéma s’engagent à ne plus collaborer avec les instances israéliennes qu’elles jugent complices de l’oppression des Palestiniens.
« Nous reconnaissons le pouvoir que le cinéma a de façonner les perceptions. En cette période de crise urgente, où nombre de nos gouvernements continuent de permettre le carnage à Gaza, nous devons tout mettre en œuvre afin de lutter contre la complicité avec cette horreur sans fin », expliquent-ils dans leur lettre ouverte.
Avant d’ajouter : « Défendre l’égalité, la justice, et la liberté pour tous est un devoir moral profond que nul d’entre nous ne peut ignorer. Nous devons donc dénoncer dès maintenant les préjudices causés au peuple palestinien. »
Outre les noms cités plus haut, figurent aussi sur le site ceux d’Olivia Coleman, de Javier Bardem, de la réalisatrice Ava DuVernay, des stars de la dernière saison de The White Lotus Aime Lou Wood et Charlotte Le Bon, ainsi que ceux du cinéaste québécois Xavier Dolan ou des actrices françaises Nina Meurisse, Blanche Gardin et Camélia Jordana.
Les institutions visées
« Nous nous engageons à ne pas projeter de films, à ne pas apparaître dans des institutions cinématographiques israéliennes, ni à ne pas collaborer avec elles (y compris les festivals, les cinémas, les chaînes de télévision et les sociétés de production) impliquées dans le génocide et l’apartheid contre le peuple palestinien », poursuivent-ils.
Comment identifier ces institutions ? À cette question, les signataires apportent plusieurs éléments de réponse. Ils évoquent les diffuseurs privés et publics, qui « participent depuis des décennies à la dissimulation, à la négation et à la justification des crimes de guerre commis par Israël ».
Ils pointent également du doigt certains festivals, comme le Festival du film de Jérusalem, le Festival international du film d’Haïfa, Docaviv et TLVfest, qu’ils estiment continuer à « collaborer avec le gouvernement israélien ». Quant à « la grande majorité des sociétés de production et de distribution », elles « n’ont jamais pleinement endossé les droits internationalement reconnus du peuple palestinien », selon eux.
Cependant, précisent les signataires, il existe « quelques entités cinématographiques israéliennes qui ne sont pas complices ». Leur engagement ne les interdit pas non plus de travailler avec des individus israéliens. Il vise la complicité institutionnelle, et non l’identité.
Le boycott culturel de l’apartheid
S’appuyant sur les propos de la Cour internationale de justice, qui a estimé au mois de janvier qu’il existait un risque de génocide à Gaza, ce mouvement d’ampleur dans le monde du cinéma s’inspire du grand boycott culturel mené par une fronde d’artistes contre le régime de l’apartheid en Afrique du Sud à l’époque. Plusieurs cinéastes, comme Martin Scorsese, avaient par exemple refusé d’y projeter leurs films.
Alors que The Voice of Hind Rajab, un nouveau long-métrage très attendu sur une fillette de six ans tuée par les forces israéliennes à Gaza en 2024, a créé beaucoup d’émoi à la dernière Mostra de Venise (et reçu une standing ovation de 23 minutes), plusieurs dizaines de cinéastes palestiniens ont accusé, il y a un an, Hollywood d’avoir contribué à la déshumanisation du peuple palestinien au cours des dernières décennies.
Des mots forts qu’ils avaient accompagnés d’un appel « à dénoncer ce génocide et l’effacement, le racisme et la censure qui le rendent possible », d’une part. De l’autre, « à faire tout ce qui est humainement possible pour mettre fin à la complicité avec cette horreur indescriptible », ont-ils écrit dans leur lettre relayée par le magazine Variety. La réponse de leurs pairs est en cours.