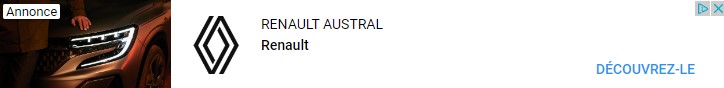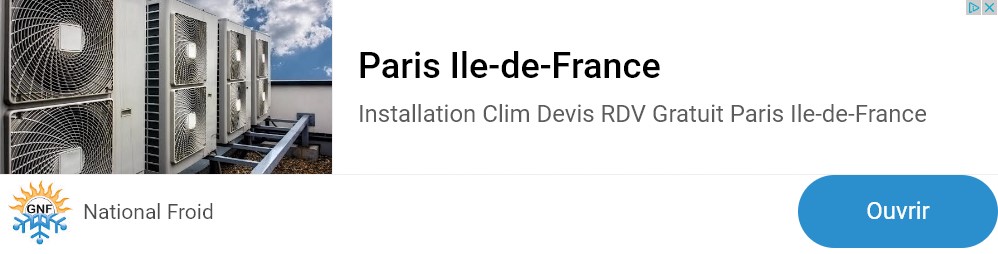Avec la réforme des retraites, Lecornu liquide le texte qui pourrit le 2e mandat de Macron
POLITIQUE – À quoi ça tient, une stabilité gouvernementale. Lors de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a brisé le tabou ultime en Macronie. Face à l’instabilité gouvernementale, et la censure socialiste qui menace un exécutif plus fragile que jamais, le Premier ministre a lâché la seule réforme structurelle à mettre au bilan d’Emmanuel Macron : celle sur les retraites, adoptée au forceps en 2023.
Un geste qui permet d’obtenir la mansuétude des députés socialistes, qui auront beau jeu d’exhiber ce scalp en circonscription, et de rendre ce dossier à une « Conférence sur les retraites et le travail, en accord avec les partenaires sociaux », selon les mots du chef du gouvernement.
Il faut se souvenir des réactions éruptives observées en Macronie ces derniers jours, après l’évocation de ce scénario par Élisabeth Borne (qui a pourtant porté ce texte impopulaire) pour mesurer la taille de la couleuvre avalée par le camp présidentiel afin d’éviter une censure synonyme, de l’aveu même du chef de l’État, de dissolution.
Acculé par une coalition d’opposition et disposant d’un socle particulièrement fragile, Sébastien Lecornu a donc fini par solder ce sujet qui ne cesse de pourrir le second quinquennat d’Emmanuel Macron. Un texte qui, dès le départ, portait tous les stigmates du défaut de fabrication. Remis sur le métier fin 2022 après une première tentative de réforme ambitieuse avortée en raison de la crise sanitaire, le projet imaginé par un Emmanuel Macron déjà dépourvu de majorité absolue, se concentre sur l’âge légal de départ à la retraite. Soit la seule ligne rouge partagée par tous les syndicats.
Un texte mal parti
En décembre 2022, l’exécutif annonce la présentation de son projet avant les fêtes. Les oppositions montent au créneau, en dénonçant le « cadeau de Noël » empoisonné offert par Emmanuel Macron aux Français. Premiers conciliabules au sommet et premier recul : le texte est finalement présenté début janvier. La réforme se fera via un Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, provoquant de nombreuses critiques, en raison des contraintes de temps que ce véhicule législatif (qui n’est pas fait pour réformer les retraites) exige.
Puis ce sont plusieurs effets de la réforme qui cristallisent la tension. Alors ministre en charge du dossier, Franck Riester admet en plateau en janvier de 2023 que la réforme devrait « pénaliser » les femmes. L’argument d’une retraite minimum à 1 200 euros s’effondre comme un château de cartes. En parallèle, les sondages négatifs s’enchaînent et des millions de Français battent le pavé dans la rue. Essentiellement consacrée à toper avec Les Républicains pour faire passer son texte, Élisabeth Borne va se faire piéger par ce groupe insaisissable, présidé à l’époque par le très anti-macroniste Olivier Marleix.
Avec un effet désastreux pour l’exécutif : les concessions promises rabotent les économies espérées par le report de l’âge légal, démonétisant le principal argument de la réforme. Le projet devient inaudible. Pendant qu’Olivier Dussopt ose vanter une « réforme de gauche », la Macronie ne cesse d’affirmer que la droite devrait se ranger derrière le texte, ayant toujours plaidé pour l’allongement du temps de travail.
Un texte mal adopté
Les jours passent, et un consensus sur la réforme à l’Assemblée paraît impossible. Certes, l’examen au Sénat paraît plus simple, mais les méthodes utilisées au Palais du Luxembourg (comme le vote bloqué), nourrit les procès en « fébrilité » instruits par l’opposition. La suite est connue. Faute de consensus, Élisabeth Borne dégaine l’article 49-3 pour faire passer ce texte, ce qui a pour conséquence directe d’enflammer la rue et installe durablement l’image d’un texte passé en force, ayant offert des images d’une Assemblée (déjà) chaotique interpellant la presse étrangère.
De quoi maintenir les envies de revanche au sein des oppositions, qui multiplient les initiatives visant à obtenir un vote sur l’allongement de l’âge légal, remettant régulièrement cette réforme (toujours honnie dans l’opinion) à l’ordre du jour, malgré les manœuvres du bloc central pour empêcher l’examen, que ce soit à travers un usage contesté de l’article 40 par Yaël Braun-Pivet, ou via l’obstruction organisée par les troupes macronistes au Palais Bourbon il y a encore un an. Car entre-temps, la dissolution est passée par là. Et la Macronie, qui a pourtant perdu des plumes à l’été 2024, s’est accrochée à ce totem et ce, même après l’élection d’une Assemblée nationale comptant deux députés sur trois hostiles à ce dispositif.
Un texte jamais digéré
Conscient de la toxicité de ce texte et du malaise démocratique que son adoption a provoqué, le Premier ministre Michel Barnier avait annoncé vouloir « aménager » la réforme des retraites, mais sans faire marche arrière sur l’âge légal. Il a été censuré. Puis c’est son successeur François Bayrou qui, une fois arrivé à Matignon, a cru déjouer le piège en annonçant un « conclave » sur les retraites, afin d’acheter la mansuétude des socialistes.
Or, sitôt le compromis trouvé, il sabote le processus : en présentant un chiffrage alarmiste qui ne correspond pas à celui des partenaires sociaux, en actant l’impossibilité de revenir sur l’âge de départ et en louvoyant sur la possibilité de soumettre la conclusion du « conclave » au vote du Parlement. Le Palois voit son initiative terminer en eau de boudin, à l’image de son passage à Matignon qui s’achève début septembre.
Après avoir goûté à la fin de bail anticipée en raison du coup de sang de Bruno Retailleau, Sébastien Lecornu a fini par obtenir, plus par nécessité que par désir de détricoter ce seul acquis de l’ère Macron, ce que ses deux prédécesseurs n’ont pas réussi à avoir : l’autorisation du chef de l’État de sacrifier ce texte symbolique sur l’autel d’une stabilité espérée. Une initiative chiffrée à 400 millions d’euros pour 2026 et 1,7 milliard pour 2027 qui permet au Premier ministre d’échapper à la censure des socialistes et à la chute (encore) prématurée de son gouvernement. Voilà le coût, non négligeable, de la stabilité. À ce stade, rien ne garantit qu’elle sera durable jusqu’à la prochaine présidentielle.