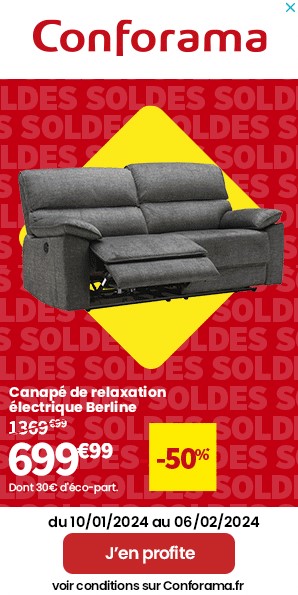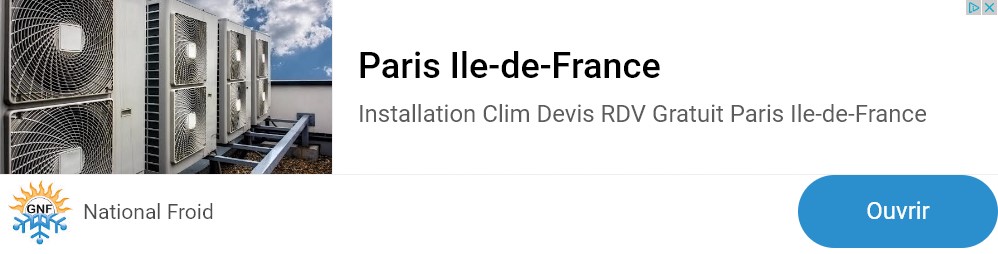Comment le Sénat est devenu le meilleur allié du gouvernement contre « ceux qui tweetent »
POLITIQUE – Les sénateurs ont la cote. C’était loin d’être le cas en 2019, quand, à la faveur de la crise des Gilets Jaunes, Emmanuel Macron interrogeait les Français sur une éventuelle « transformation » du Palais du Luxembourg. Les élus concernés s’étranglent. Fort de sa majorité à l’Assemblée nationale, le chef de l’État chercherait-il à tuer le bicamérisme ? Cinq ans plus tard, la question n’est plus d’actualité et jamais le Sénat n’a eu autant d’importance aux yeux de l’exécutif.
C’est sans doute le député Ensemble pour la République Jean-René Cazeneuve qui le résume le mieux : « L’Assemblée tweete, le Sénat légifère », soupire-t-il le 2 juillet dernier sur LCP, alors que ses collègues viennent de voter une motion de rejet pour empêcher l’examen de la controversée réforme de l’audiovisuel public. De là à dépeindre les députés en enfants terribles, uniquement amateurs de punchlines et obnubilés par leur visibilité sur leurs réseaux sociaux ?
En réalité, si l’Assemblée nationale souffre de la comparaison avec le Sénat, c’est principalement lié à sa composition. Une situation apparue dès 2022 et devenue criante à la lumière des résultats des législatives anticipées de l’été dernier.
Une presque majorité confortable…
N’allez pas croire que le Sénat dispose de la majorité qui manque cruellement au(x) gouvernement(s) à l’Assemblée nationale. Pour y prétendre, il faudrait qu’un groupe compte au moins 174 sénateurs dans ses rangs. Or, le groupe le plus imposant, Les Républicains, en a tout juste 130, dont le président de la chambre Gérard Larcher. Mais – et c’est la grande différence avec l’Assemblée -, les sénateurs LR travaillent souvent avec le groupe Union centriste qui compte 59 élus. Sans oublier les 19 autres du groupe macronistes RDPI. Soit un joli total de 208 voix, largement suffisantes pour faire pencher le Palais du Luxembourg d’un côté même si une ou deux dizaines de voix font parfois défaut.
Ces calculs politiques, Michel Barnier, premier Premier ministre post-dissolution, les a faits dès son arrivée à Matignon. C’est tout naturellement que le Savoyard, membre des Républicains, se tourne vers sa famille politique pour constituer son gouvernement. Mais il ne pioche pas parmi les députés, qui ont perdu une dizaine des leurs dans les législatives anticipées. Non, Michel Barnier regarde du côté des sénateurs et en débauche près d’une dizaine : Bruno Retailleau président du groupe est propulsé à l’Intérieur avec Jean-Noël Buffet, Sophie Primas et Agnès Canayer y sont également… Prenant sa place trois petits mois plus tard, François Bayrou rééquilibre (très) légèrement le glissement à droite mais conserve la prime à la logique sénatoriale : sept membres de son gouvernement ont jadis occupé un siège au Palais du Luxembourg.
Alors qu’à l’Assemblée, le concept de « majorité » est devenu très aléatoire, le gouvernement s’appuie sur le Sénat. Entre le 1er octobre 2024 et le 13 juillet 2025, sur les 71 textes adoptés, 22 viennent du Sénat, selon le rapport d’activité de l’institution, soit 10 de plus que lors de la session précédente. Et pour la plupart, ils reçoivent la bénédiction du gouvernement. C’est par exemple le cas de la loi Duplomb, proposée à l’origine par le sénateur LR du même nom. La réforme de l’audiovisuel public, défendue corps et âme par Rachida Dati, vient aussi des LR et a été adoptée par la Chambre haute quand l’Assemblée l’a rejetée par deux fois. À l’inverse, la taxe Zucman votée à l’Assemblée a été retoquée au Sénat… là encore raccord avec le gouvernement. Décidément.
… Mais pas forcément docile
Après avoir laissé la part belle aux propositions de loi, le gouvernement de François Bayrou entend reprendre la main à la rentrée, en multipliant les projets de loi. Quatre d’entre eux ont été présentés lors du dernier conseil des ministres avant la pause estivale : la loi constitutionnelle sur le statut de la Corse, la réforme sur la régulation de l’enseignement supérieur privé, le projet de loi pour lutter contre la vie chère dans les Outre-mer et un dernier sur la restitution de biens culturels. S’y ajouteront la réforme judiciaire de Gérald Darmanin, un projet de loi contre la fraude sociale, un autre sur la protection de l’enfance…
Le Sénat est bien parti pour rester au centre du jeu. Trois de ces textes commenceront leur parcours législatif par le Palais du Luxembourg, a tranché le gouvernement. Sous réserve de son dépôt et de la convocation de la session extraordinaire, celui sur la restitution des biens culturels est prévu à l’ordre du jour le 24 septembre. Il devrait être suivi par celui sur la vie chère ultramarine (29 septembre) puis par la réforme constitutionnelle sur la Corse, que le ministre François Rebsamen espère voir examinée « du 17 au 21 octobre » avant un passage à l’Assemblée « fin novembre ».
Ce dernier dossier pourrait bien tendre les relations entre le gouvernement et son nouveau chouchou parlementaire. Juste avant la coupure estivale déjà, l’adoption de la loi PLM a tourné au bras de fer entre les deux, pour la première fois sous l’ère Bayrou. La réforme du statut de la Corse risque bien d’ajouter de l’huile sur le feu, en particulier avec son indéboulonnable président Gérard Larcher, mécontent de la décision de François Bayrou de ne pas prendre en compte l’avis du Conseil d’État.
Mais avant la Corse, le projet de loi de finances 2026 sera sans doute l’occasion pour la Chambre haute de profiter de son pouvoir retrouvé : si la droite a globalement salué la « prise de conscience (du Premier ministre) sur la nécessité de réduire le déficit et la dette publique », elle souhaite aller plus loin sur les dépenses publiques (avec l’immigration dans son viseur). Et moins loin sur les efforts demandés aux collectivités locales. Dans ce bras de fer où François Bayrou joue sa place, le Sénat a des atouts dans sa manche.