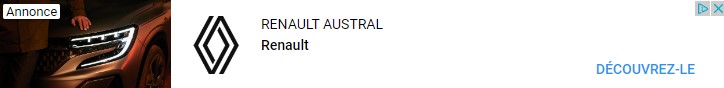Vue de Belgique, experte en instabilité politique, la situation française n’a rien de rassurant
POLITIQUE – 27 jours après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jeté l’éponge ce lundi 6 octobre. Et ce, quelques heures seulement après avoir composé son gouvernement, fruits d’âpres négociations ces dernières semaines.
Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, il laisse la France dans une nouvelle période d’immobilisme inquiétante en ayant échoué à former un gouvernement de coalition suffisamment solide, plus d’un an après la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron.
Dans un tel contexte, Le HuffPost a souhaité donner la parole à notre voisin belge par la voix de Baptiste Hupin, journaliste politique à la RTBF. Il faut dire que le pays est connu pour ses longues périodes de vacance du pouvoir du fait de son système de gouvernance complexe (en partie dû à un paysage politique très éclaté avec des ailes francophones et flamandes dans chaque formation politique). La France suit-elle la même trajectoire ? Le journaliste analyse comment la Belgique traverse ce genre de crise. Et relève au passage ce qui fait toute la différence avec le cas français.
Le HuffPost. Comment analysez-vous la situation politique française après la démission surprise de Sébastien Lecornu ? Êtes-vous plutôt amusé, inquiet, perplexe ?
Baptiste Hupin. Il y a une certaine forme d’inquiétude. On n’est absolument pas ravis de voir que vous connaissez les mêmes turpitudes que nous. Inquiétude parce que la France est un partenaire majeur de la Belgique. Inquiétude aussi parce que c’est un pays européen important, dont la stabilité politique était jusqu’ici lisible. Désormais, on a le sentiment, de notre côté de la frontière, de ne pas voir de solution.
La Belgique repose sur un système de gouvernance complexe et technique. Comment la vie politique belge se poursuit-elle lors de ces longues périodes de blocage ?
Il faut reconnaître que la Belgique trouve une certaine forme de stabilité dans cette complexité. D’abord parce qu’on est un système proportionnel. Les gouvernements de coalition sont la norme en Belgique, avec des coalitions très très larges dues à un paysage politique éclaté. Il n’est pas rare d’avoir des gouvernements à minimum 4-5 partis. Le gouvernement précédent en comptait 7, celui-ci en compte 5.
Notre système est complexe mais en cas de crise politique prolongée, c’est aussi un gage de stabilité. Comme nous sommes un pays fédéral, lorsqu’un gouvernement est à l’arrêt, il y a toute une série d’autres gouvernements régionaux et communautaires qui fonctionnent toujours. Comme en 2010-2011 [541 jours sans gouvernement de plein exercice, ndlr], ou l’année dernière, lorsqu’on est resté 8 mois sans gouvernement fédéral. Le gouvernement communautaire, par exemple, qui s’occupe de tout ce qui est enseignement, culture, médias, sport. Les gouvernements régionaux s’occupent, eux, de tout ce qui touche à l’aspect territorial, la mobilité, l’agriculture, une grande partie de l’économie et de l’emploi. Donc il y a toujours une partie de l’État qui fonctionne à 100 %.
En revanche, l’État fédéral assure tout ce qui est sécurité sociale, justice, défense, police, toutes les grandes compétences régaliennes. Les affaires courantes, c’est une notion assez mouvante qui tient plus de la coutume que de la règle constitutionnelle. C’est un exemple que l’on donne souvent, mais la Belgique a accepté de participer à des bombardements en Libye en 2011, alors qu’elle était dans la gestion des affaires courantes. Le Parlement a tout simplement voté et donné une légitimité démocratique au gouvernement à ce moment-là.
Comment la population belge réagit-elle à ces périodes d’immobilisme gouvernemental ?
Je crois que la population belge relativise beaucoup. En 2010-2011, il y a eu quelques grandes manifestations mais c’est parce qu’il y avait à ce moment-là une vraie crainte autour du modèle fédéral belge. Certains y voyaient un risque existentiel pour le pays en tant que tel.
Mais lors de la dernière crise gouvernementale, personne n’a levé le petit doigt. Il n’y avait pas vraiment de crainte. Une forme d’habitude s’est installée au sein de la population. On regarde donc ça avec un certain flegme, dans le meilleur des cas, et avec une certaine indifférence si on voit les choses de manière négative. Mais c’est aussi parce que le pays n’est jamais totalement à l’arrêt.
Quel conseil prodiguer aux Français, à la lumière de l’expérience belge en la matière ?
Je n’ai pas vraiment de conseils à donner aux Français. La seule chose, c’est de voir ce qui fonctionne chez nous dans ces grands moments de crise. En Belgique, les grands hommes et femmes d’État sont plutôt des figures de compromis que des gens qui ont su marquer leur époque par une vision idéologique très claire et appuyée.
Le compromis est fortement valorisé en Belgique. Et pour rentrer dans une logique de compromis, il faut voir son adversaire comme un partenaire de négociation, ce qui est très compliqué dans un système comme celui de la France, où le paysage politique actuel est composé de trois blocs. Chez nous, la facilité, c’est qu’on négocie à quatre, à cinq, à six. C’est un billard à plusieurs bandes et on peut toujours obtenir quelque chose de l’autre.
Le compromis n’est pas synonyme de compromission. Il faut donc avoir une approche très pragmatique, moins idéologique. Et entrer dans une logique transactionnelle… même si ce n’est pas ce qu’il y a de plus noble en politique.