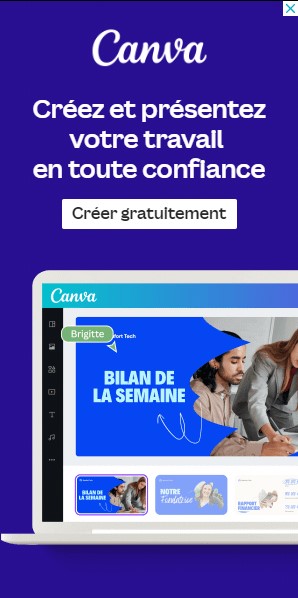« Être diagnostiqué de la maladie de Parkinson à 30 ans ne m’a pas empêché de devenir papa »
TÉMOIGNAGE – L’année de mes 30 ans, j’ai été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Je ne l’avais absolument pas vu venir : pour moi, ce mot était associé aux personnes âgées et aux cheveux grisonnants, et je n’aurais jamais pensé pouvoir en être atteint.
Les premiers symptômes se sont installés doucement, au début de la pandémie de Covid-19. J’ai d’abord remarqué une gêne au moment de poser mon talon au sol. Du jour au lendemain, quand je marchais, mon pied gauche faisait du bruit sans que je ne puisse l’expliquer, mais je n’avais pas mal. J’avais aussi des douleurs au niveau de l’épaule gauche, sans trop savoir pourquoi. Ça ne m’a pas interpellé : les changements ont été si lents et progressifs que je ne m’en suis pas rendu compte.
C’est ma mère qui, en remarquant mon changement de démarche, m’a incité à aller voir un spécialiste. Par chance, elle travaille dans la santé et a pu m’aider à trouver un rendez-vous avec un neurologue.
Le diagnostic de ma maladie de Parkinson
Le spécialiste a testé mes réflexes et m’a fait passer plusieurs tests cognitifs, sans que je ne comprenne pourquoi. À la fin de la consultation, il m’a dit que j’avais des « symptômes parkinsoniens », sans se prononcer définitivement. Ensuite, il m’a prescrit un DAT Scan [imagerie du cerveau, ndlr] pour confirmer son diagnostic.
Je suis allé au rendez-vous suivant dans un déni complet, sans m’être renseigné sur quoi que ce soit, accompagné de ma mère. Nous étions en pleine pandémie, mais quand nous sommes entrés dans son bureau, il a retiré son masque. Devant ce geste symbolique, j’ai compris qu’il allait m’annoncer une mauvaise nouvelle.
Ce fut le cas : il m’a expliqué que j’avais une maladie de Parkinson, et m’a demandé si j’avais des questions. Sonné, je n’en ai posé qu’une : « Est-ce qu’une guérison est possible ? » Il m’a répondu « Pas à ce jour », avant de m’expliquer mon cas était très rare mais que chez les jeunes, la maladie pouvait se développer très lentement – surtout si je continuais à faire du sport et à avoir une bonne hygiène de vie. Il m’a fait une ordonnance, et mon traitement a commencé.
Admettre la maladie et l’annoncer aux autres
Pendant un moment, j’ai gardé ma maladie pour moi. D’abord parce que je voulais en parler à mes amis de vive voix et ce n’était pas possible pendant le confinement, mais aussi parce que l’annoncer aux autres était difficile. Je craignais les réactions comme « Ce n’est pas possible, tu es trop jeune » et de devoir tout expliquer. J’avais du mal à trouver les mots. Et surtout, le dire à tout le monde impliquait de sortir du déni dans lequel j’étais et cela m’a pris du temps.
Au travail, je l’ai seulement dit à mon supérieur direct et pendant un temps, cela a suffi. Petit à petit, j’en ai parlé au compte-goutte. Je prenais des pincettes en disant « j’ai des symptômes parkinsoniens » plutôt que de nommer directement ma maladie. Parfois, on me posait des questions sur d’autres symptômes qui se manifestaient : pourquoi est-ce que j’étais toujours fatigué ? Pourquoi ces raideurs dans ma nuque ? Il m’est arrivé de mentir, mais j’ai pris conscience que dire la vérité me facilitait les choses.
Mon nouveau quotidien
Cela fait maintenant quatre ans que j’ai été diagnostiqué et mon quotidien a évolué, tout comme mes symptômes. Je prends des médicaments au long de la journée pour me permettre de continuer à marcher et à garder de la dextérité. Ils sont très efficaces : j’ai l’impression de prendre une potion magique dont l’effet se dissipe peu à peu. Mais quand je suis assis avec des amis, j’ai souvent peur d’oublier le temps qui passe et de ne pas pouvoir me lever au moment de partir. Les effets secondaires peuvent être intenses, voire un peu contre-productifs : parmi mes symptômes, il y a la fatigue chronique par exemple, mais l’un de mes médicaments donne des somnolences. Un autre est corrélé à des comportements addictifs, j’en ai fait les frais avec les cartes Pokémon ou les jeux vidéo.
Dans l’absolu cependant, j’ai gardé la plupart de mes anciennes habitudes. Par contre, je sors beaucoup moins le soir (je suis beaucoup plus fatigué après 22 heures, quand la fatigue de la journée s’ajoute aux symptômes), et je bois moins d’alcool. Ce qui a changé, c’est plutôt ma vie de famille !
Oser en parler en rencart
Quand j’ai été diagnostiqué, j’étais célibataire. Quand j’ai rencontré celle qui est aujourd’hui ma femme, je n’ai pas osé lui en parler tout de suite. C’était très stressant pour moi. Je n’avais pas envie de lui dire d’entrée de jeu, mais en même temps, je me disais qu’il fallait que je lui dise le plus tôt possible. Plus on attend et plus on se dit « Qu’est-ce qu’elle va penser si je lui dis si tard ? ».
Anxieux, j’ai repoussé l’échéance autant que je pouvais, mais elle n’était pas dupe. Ma compagne travaille dans la santé, et elle se doutait de certaines choses : au premier rendez-vous, elle s’est demandé si j’avais fumé de l’herbe parce que mes réflexes n’étaient pas très affûtés, elle m’a aussi demandé si j’avais déjà fait un AVC. Après avoir perdu l’équilibre en sa présence, j’ai fini par lui en parler. Elle s’est renseignée, a découvert que ce n’était pas une maladie mortelle et que chez les jeunes, elle se développait lentement. Nous en parlons librement, et ce n’est pas un tabou entre nous.
Avoir des enfants après son diagnostic
Quand j’ai été diagnostiqué, je me suis interdit de devenir père. Je ne savais pas, à l’époque, que Parkinson n’était pas forcément héréditaire. Malgré mon envie de devenir parent, je me disais « C’est déjà difficile de s’occuper de moi-même avec ma fatigue et mes symptômes, je ne vais pas m’occuper d’un enfant en plus ». Ma compagne a réussi à me convaincre d’envisager cette option.
La première étape était de faire un test ADN pour savoir si j’avais des gènes porteurs de la maladie. Il s’est avéré que non, et nous avons pu commencer à en parler. Nous étions prêts tous les deux et aujourd’hui, nous avons une fille de quatre mois. Je ne regrette absolument rien ! J’avais peur d’avoir du mal à me lever la nuit, mais mon neurologue a adapté mon traitement pour faciliter les choses. Nous communiquons beaucoup avec ma femme, et je fais attention aux signes : si je sens que mon équilibre est précaire, je ne porte pas notre fille, par exemple.
Vivre au jour le jour et rester optimiste
Aujourd’hui, je peux dire sans aucun complexe que j’ai la maladie de Parkinson. Depuis deux ans, je parle de ma maladie sur les réseaux sociaux, et cela m’a beaucoup aidé. Il y a un côté cathartique à répéter ses symptômes, à parler de son histoire. Ça permet aussi de sensibiliser les autres et de dire « Regardez, je suis jeune, ma main ne tremble pas et pourtant, j’ai Parkinson ».
On me demande souvent si j’ai peur pour l’avenir, mais depuis que j’ai été diagnostiqué, je vis beaucoup plus le moment présent. Je suis bien moins stressé. Arriver en retard au travail ou oublier de payer mes impôts, des choses qui m’angoissaient énormément auparavant, ne m’inquiètent plus du tout aujourd’hui. D’abord, parce que le stress n’est pas bon pour ma condition, mais aussi parce que le quotidien de malade accapare la plupart de mes inquiétudes. Je me sens plus détaché, mais aussi optimiste : je suis jeune, la maladie se développe lentement, je suis suivi, la recherche avance. Demain, un nouveau médicament hyperefficace pourrait bien voir le jour.
De manière générale, je vis bien : malgré le choc de l’annonce et toutes les difficultés d’une maladie chronique, la vie trouve son chemin.
À voir également sur Le HuffPost :
La lecture de ce contenu est susceptible d’entraîner un dépôt de cookies de la part de l’opérateur tiers qui l’héberge. Compte-tenu des choix que vous avez exprimés en matière de dépôt de cookies, nous avons bloqué l’affichage de ce contenu. Si vous souhaitez y accéder, vous devez accepter la catégorie de cookies “Contenus tiers” en cliquant sur le bouton ci-dessous.